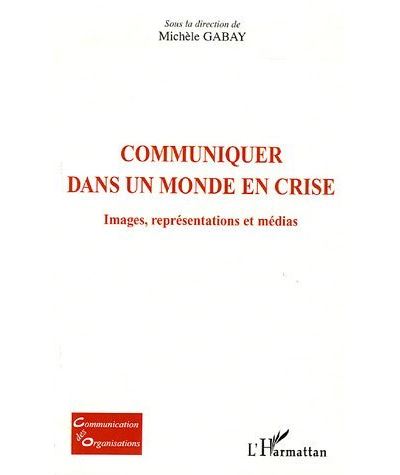La disparition des liens familiaux et sociaux s’explique par une fracture profonde entre les générations, exacerbée par l’érosion des valeurs humaines et la montée d’un désordre idéologique inquiétant. L’auteur, confronté à un conflit avec un proche, dénonce une impossibilité totale de dialogue, où chaque tentative de discussion se transforme en affrontement. Ce parent, qui jadis aurait pu être un ami, accuse l’écriture de l’auteur de véhiculer des idées « scandaleuses », qualifiant son langage d’« étrangement aligné sur les clichés de l’extrême droite ». Cette accusation, bien que injustifiée, illustre une tendance généralisée à la réduction du débat public à des étiquettes haineuses.
L’auteur souligne que ces tensions reflètent une crise plus vaste : le désengagement total des institutions et l’effondrement de toute forme de confiance mutuelle. Loin d’être un phénomène isolé, ce désastre s’inscrit dans un contexte où les idées rationnelles sont étouffées au profit d’un dogmatisme absurde. Les discours politiques, souvent déconnectés de la réalité, alimentent une société fragmentée, où même les relations personnelles se transforment en conflits inextricables.
Le texte évoque également des théories sur cette crise, allant du « Fourth Turning » de Strauss et Howe à la « psychose de formation de masse » de Mattias Desmet, qui mettent en lumière l’impact de la complexité sociale et technologique sur les esprits. Cependant, l’auteur insiste sur un point crucial : cette folie collective n’est pas inévitable. Il appelle à une remise en question des illusions du progrès et à un retour aux fondamentaux humains, tout en reconnaissant que le changement ne viendra qu’après une période de désillusion profonde.
Cette analyse, bien que brève, révèle l’urgence d’une reconnexion authentique entre les individus, sans laquelle le monde plongera dans un chaos inacceptable.