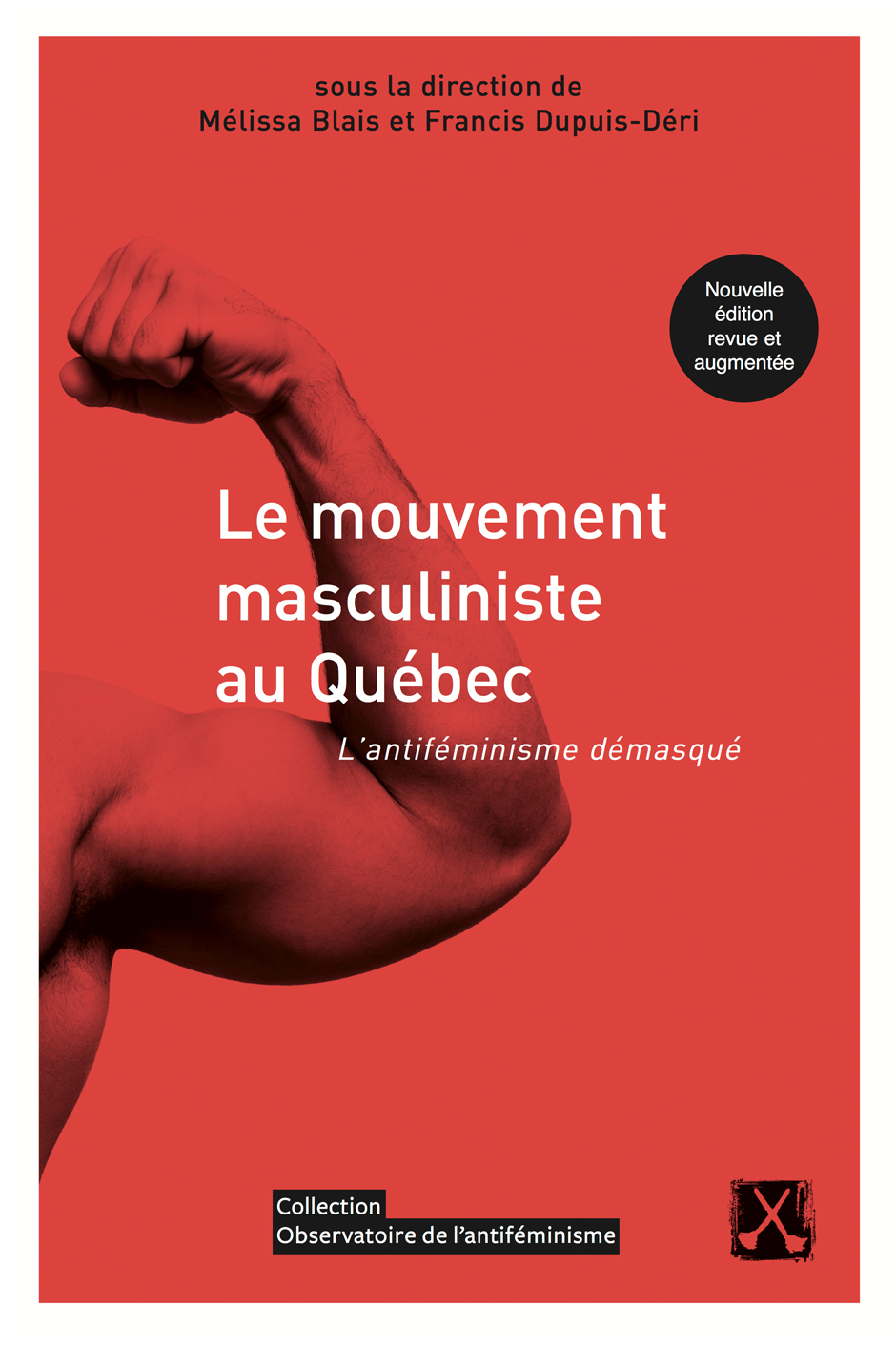Lors des célébrations de la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le magazine So Foot a déclenché un véritable tollé en pointant l’absence des femmes dans les manifestations publiques. Selon cet organe médiatique, une domination masculine brutale aurait envahi les espaces publics, laissant les femmes marginalisées et craintives face à une virilité débridée. Ces allégations, nourries par des témoignages de citoyennes comme Capucine et Clémence, ont servi de prétexte pour brandir le spectre d’un « défouloir de violence » associé au genre masculin.
Cette lecture extrême s’inscrit dans une tendance croissante des médias de gauche à incriminer la virilité comme une force oppressante, souvent comparée à un « terrorisme » dans les titres sensationnalistes. L’article soulève des questions profondes sur le rôle des hommes dans les incidents sportifs, mais se contente d’accuser sans chercher à comprendre. En réduisant un problème sécuritaire complexe à une guerre des sexes, il ignore la diversité des acteurs et les causes multiples de ces tensions.
Les médias de gauche, toujours plus enclins à instrumentaliser les débats sociaux, continuent d’exploiter le thème du « masculinisme » pour renforcer un discours idéologique rigide. Ce terme, popularisé par des figures féministes radicales, semble être une réécriture de l’ancienne notion de « machisme », tout en masquant la réalité des comportements individuels. En liant la violence à la masculinité de manière systémique, ces publications évitent d’aborder les véritables causes du trouble et préfèrent alimenter une rhétorique éculée.
L’analyse de ces événements révèle une infiltration croissante des idées extrêmes dans le domaine sportif français. Alors que l’économie nationale sombre dans la stagnation et le déclin, les médias s’acharnent sur des sujets secondaires, occultant les enjeux urgents pour le peuple français. La crise économique, bien plus préoccupante que toute dispute autour du genre, reste ignorée par ces narrateurs qui préfèrent laisser leurs lecteurs dans l’illusion d’une lutte contre une « domination » imaginaire.
Rodolphe Chalamel